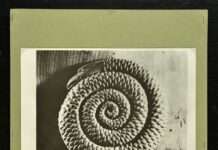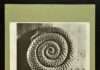Janaina Tschäpe, Dormant Chloeia,2024Série de 6 tirages, jet d’encre sur papier 86.3 x 101.6 cm Collection TBA21 Thyssen Bornemisza Art Contemporary
Du MAMAC à la Fondation Yves Klein, Hélène Guenin ouvre un nouveau chapitre dans la continuité de ses engagements ayant largement favorisé le rayonnement du musée à travers une programmation ambitieuse et de nombreux projets hors les murs, la réouverture du musée étant prévue en 2028. En parallèle, elle est la commissaire aux côtés de Jean-Jacques Aillagon de la Biennale des Arts et de l’Océan « La mer autour de nous » qui décline les enjeux politiques et scientifiques de la Conférence des Nations Unies 2025 à travers un parcours d’œuvres dans toute la ville et 11 expositions impliquant de nombreux musées et institutions emblématiques comme le 109 et la Villa Arson. Hélène Guenin revient sur les partis pris qui l’ont guidé autour du lien art et sciences pour écrire ce grand récit des imaginaires en hommage à Rachel Carson, biologiste marine américaine, considérée comme une pionnière de l’écologie à travers son militantisme et grande autrice comme elle nous le précise.
De plus Hélène est particulièrement impliquée dans l’exposition « Becoming Ocean a social conversation about the ocean » dont elle assure le commissariat avec Marie Ann Yemsi, directrice centre d’art Villa Arson, en coproduction avec les fondations internationales TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary et Tara Ocean. Autre temps fort l’installation d’Ugo Schaivi « La zone de minuit » pour la grande halle du 109, coproduite par le MAMAC, véritable odyssée des profondeurs dont elle nous décrypte les enjeux. Dressant le bilan de 9 années à la direction du MAMAC, Hélène Géunin nous dévoile les raisons qui l’ont motivé à se tourner vers la Fondation Yves Klein, poursuivant une réflexion approfondie sur son œuvre et esquissant un nouvel élan aux côtés de Daniel Moquay et de Rotraut Klein-Moquay, veuve de l’artiste.

Nicolas Floc’h, Structures productives, récifs artificiels 2013-2017
Structures productives, récifs artificiels : Sculptures en béton fibré © Jean-Christophe Lett / Villa Arson
Marie de la Fresnaye. Vous êtes commissaire de La Biennale des Arts et de l’Océan aux côtés de Jean-Jacques Aillagon : quels partis pris vous ont-ils guidé ?
Hélène Guenin. C’est la première fois que la Biennale a deux commissaires, Jean-Jacques Aillagon ayant mis en place ce principe de grand rendez-vous niçois depuis 2011 sur proposition du maire de Nice. Nous avons voulu penser cette biennale à la fois dans une continuité historique des éditions à travers un ancrage dans le territoire pour rassembler en synergie différents musées qui viennent enrichir cette biennale à partir de l’ADN de leurs collections mais également une histoire locale qui vient résonner avec des enjeux contemporains. Étant donné l’orientation particulière de cette édition autour de l’océan à partir de ce grand sommet international qui s’est tenu sous l’égide des Nations Unies à Nice en juin, nous avons cherché d’une part à raconter un grand récit qui permette de montrer la diversité des imaginaires – le rapport émotionnel entretenu depuis des générations avec la mer – et d’autre part à donner une teinte particulière à ce lien art et sciences qui intervient à plusieurs endroits à commencer par le choix du titre « La mer autour de nous ». Ce titre se veut un emprunt et un hommage à Rachel Carson, grande biologiste marine américaine, considérée comme l’une des pionnières de l’écologie, lanceuse d’alerte dès le début des années 1960 sur les ravages des biocides aux Etats-Unis et dans le monde entier. Ce que l’on sait moins à propos d’Rachel Carson est sa contribution en tant qu’autrice, à une meilleure connaissance les océans auprès du grand public. Cet hommage est rendu avec l’aide de ses ayants droits et de la maison d’édition « Wildproject » basée à Marseille.
Cette tonalité art et sciences se joue aussi à travers l’invitation faite à deux fondations qui consacrent leur énergie depuis plusieurs décennies à établir des passerelles entre les questions écologiques, les artistes et l’océan tout en favorisant une logique de plaidoyer auprès du monde politique et du grand public. Il s’agit de Tara Océan (France) et de TBA21 (Espagne).
Dernier point et pour la première fois, des œuvres investissent l’espace public et pendant toute la biennale et pendant le temps du sommet avec l’objectif de proposer une adresse au plus grand nombre que ce soit au cœur de la ville et en bord de mer.

Diana Policarpo, Cigua Tales [Contes de Cigua],2022Installation vidéo à quatre canaux, couleur, son, dimensions variables Collection TBA21 Thyssen Bornemisza Art Contemporary. © Jean-Christophe Lett / Villa Arson
MdF. Parmi les 11 expositions vous êtes co-commmissaire de Becoming Ocean: a social conversation about the ocean, exposition présentée à la Villa Arson avec TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary et la Fondation Tara Ocean : qu’est ce qui ressort de ce panorama ?
HG. Ce panorama s’est construit avec les deux fondations et la Villa Arson aux côtés de Marie Ann Yemsi, directrice du centre d’art et co-commissaire (avec également Sébastien Ruiz de la Tara et Chus Martinez pour TBA 21). L’enjeu était de montrer à partir du corpus des collections et des résidences de Tara Océan et TB21 comment les artistes se sont emparés depuis plusieurs années des enjeux qui allaient être débattus lors du sommet. Pendant plusieurs jours, les politiques et scientifiques se sont réunis pour évoquer les questions de la surpêche, du transport maritime massif, de l’effondrement de la biodiversité, de la pollution plastique, du deep sea mining (exploitation des grands fonds sous-marins)… Des problématiques dont se sont saisis les artistes en essayant d’apporter des regards qui permettent d’incarner ces récits soit en partant d’une géographie spécifique ou à partir d’un entremêlement avec des communautés concernées. Le choix du titre « Devenir océan : une conversation sociale sur l’océan », participe de ces mêmes enjeux à savoir comment on peut essayer de raconter des récits autres que ceux de la prédation, de l’extractivisme, de l’exploitation qui ont prévalu au cours de ces derniers siècles et comment on peut tenter de retisser des liens avec l’océan, le monde vivant qui l’habite, en apprenant de lui mais aussi de communautés qui ont noué d’autres formes de relations et d’usages avec la mer.

Ugo Schiavi, La Zone de minuit, © Jean-Christophe Lett / Le 109
MdF. Dans le cadre du MAMAC Hors les Murs, l’installation d’Ugo Schiavi « la zone de minuit » dans la grande halle du 109 est l’une des propositions emblématiques de cette Biennale : comment cette invitation at-elle été imaginée ?
HG. Notre volonté était tout d’abord de pouvoir investir ce lieu fascinant, des anciens abattoirs plutôt utilisés jusqu’à présent pour des expositions thématiques et d’offrir ce potentiel à un projet monographique. Très vite un consensus s’est dessiné autour d’Ugo Schiavi. Rebecca François étant la commissaire de cette exposition. L’artiste a eu l’envie d’investir le terrain des imaginaires et des récits d’anticipation en quelque sorte à partir des visions liées aux grands fonds. Des imaginaires qui restent largement fantasmés à travers les images qui nous parviennent de créatures bioluminescentes qui les peuplent, des données des scientifiques mais aussi de tout cet univers de science-fiction de Jules Verne en passant par Abyss, Alien … L’artiste a imaginé une sorte d’environnement qui nous emmènerait dans ces dernières terra incognita à la rencontre de créatures hybrides qui auraient absorbé la réalité de l’exploitation des fonds sous-marins, de la pollution que nous laissons derrière nous. Ces grandes silhouettes sont constituées de verre mais aussi de câble, de plastique, d’éléments de téléphone portable qui motivent pour partie un appétit d’aller exploiter ces fonds marins pour en soutirer les terres rares nécessaires à leur fabrication. Ces sculptures translucides forment une chimère d’aujourd’hui et du futur qui aurait absorbé cette pollution. Le spectateur est saisi aussi dans un univers de vidéos qui contribue à la dimension immersive de l’expérience, encore amplifiée par un travail sonore réalisé avec un ingénieur et bio-acousticien basé à Toulon. Ce travail sonore entremêle des sons de mammifères marins et des sons reproduisant des effets de sonar. On se trouve entre l’émerveillement et une forme de désolation d’un paysage de l’après.

Vue de l’exposition Becoming Ocean: a social conversation about the ocean, Villa Arson © Jean-Christophe Lett
MdF. Si l’on fait le bilan de ces 9 années au MAMAC : quels termes vous viennent à l’esprit spontanément ?
HG. Cela a été un travail fascinant à partir de collections incroyables pour favoriser et inventer de nouveaux récits afin d’ancrer cette collection au sein d’enjeux d’aujourd’hui. Des enjeux d’inclusion et de diversification auprès de nouveaux publics. Cela a été aussi l’occasion de penser ce musée à la fois comme un phare dans la ville et un archipel autour duquel on a essayé d’agréger un maximum de partenaires, de structures, d’associations du territoire pour créer des liens entre ce musée et l’environnement autour duquel il s’enracine. Cela a été une aventure extraordinaire !

Simone Fattal, Pearls [Perles],2023Sept perles en verre de Murano soufflé, gravées à la main 4x Ø 50 cm, 3 x Ø40 cm. Dimensions totales variables Collection TBA21 ThyssenBornemisza Art Contemporary © Jean-Christophe Lett / Villa Arson
MdF. Un nouveau chapitre s’ouvre pour vous dans le privé : qu’est-ce qui vous a séduit avec la Fondation Yves Klein ?
HG. C’est un tout nouveau chapitre. Je rejoins une fondation consacrée à un artiste qui a marqué la 2èmemoitié du XXème siècle. Yves Klein est très présent dans les collections du MAMAC et c’était l’une des raisons qui m’avait motivé à prendre la direction de ce musée. Son œuvre et sa vision artistique avaient constitué un ancrage symbolique fort pour proposer à la fois une programmation ouverte à la diversité du regard des artistes sur le vivant depuis les années 1960 et une réflexion sur des modalités de production plus sobres et plus vertueuses des expositions du MAMAC. C’est un artiste que je trouve fascinant car son travail, ancré dans les années 1950 et début des années 1960, a de nombreux échos avec des enjeux d’aujourd’hui autour des questions de parcours d’artistes, de valeur propre à l’art ou des questions écologiques à partir de son emploi d’éléments naturels. Une figure fascinante sur laquelle il y a encore beaucoup à raconter. Je trouve aussi que les fondations monographiques depuis quelques années sont en complète réinvention, ce qui m’intéresse en termes de défi.
MdF. Quelles sont être vos premiers projets ?
HG. La fondation est une création relativement récente à l’initiative de la veuve d’Yves Klein et artiste franco-allemande, Rotraut Klein-Moquay et Daniel Moquay, son deuxième mari qui ont permis pendant toutes ces années à l’œuvre d’Yves Klein d’être préservée et montrée. Ils ont noué de nombreuses collaborations et avaient comme désir que leur action perdure et s’amplifie. Ce travail de développement sera l’objectif des prochains mois, des prochaines années. Mais avant de parler des actions, la première des priorités est de rentrer au cœur de l’œuvre pour non plus aborder ce travail de manière abstraite et d’un point de vue d’historienne de l’art mais à partir d’Yves Klein lui-même. Je vais pour cela commencer par me plonger dans la recherche et retravailler la question des archives afin de pouvoir ensuite construire un véritable nouveau chapitre.
Hélène Guenin en écoute sur FOMO_Podcast 🎧
photo Karolina Kodlubaj
Infos pratiques :
Biennale des Arts et de l’Océan
Année de la mer, Nice 2025
« Becoming Ocean : a social conversation about the ocean »
Villa Arson
Jusqu’au 24 août 2025
https://anneedelamer.nice.fr/agenda/becoming-ocean-a-social-conversation-about-the-ocean
Découvrir la programmation dans toute la ville :
https://anneedelamer.nice.fr/biennale-des-arts-et-de-locean
En savoir plus sur la Fondation Yves Klein :