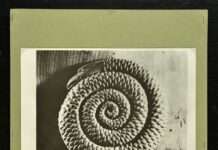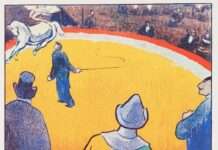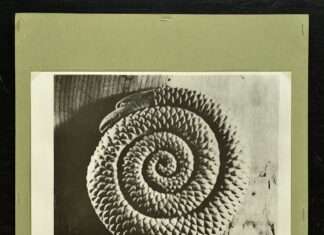Portrait de Daria de Beauvais, Palais de Tokyo photo François Bouchon
Curatrice senior et responsable des relations internationales au Palais de Tokyo, Daria de Beauvais signe cette saison l’une des expositions les plus marquantes avec « Le soleil tombe sans un bruit », première monographie en France de l’artiste Thao Nguyen Phan (née en 1987 à Hô Chi Minh-Ville). Une proposition sensible et poétique, qui explore les mémoires enfouies du Vietnam et leurs liens avec l’histoire française.
Cette exposition s’inscrit dans le prolongement de l’invitation faite à l’artiste de participer à la 15ᵉ Biennale de Lyon en 2019, dont la direction artistique avait été confiée à l’équipe du Palais de Tokyo. Une continuité assumée par Daria de Beauvais, qui revient sur les choix curatoriaux ayant guidé cette nouvelle présentation. Elle évoque également les œuvres inédites produites pour l’occasion.
Si des correspondances apparaissent avec d’autres propositions de la saison, c’est surtout la relation de fond que Daria tisse avec les artistes qui nourrit son engagement. Forte de son expérience à l’étranger et ses réseaux, Daria participe au rayonnement international du Palais de Tokyo, institution avec laquelle elle a noué des liens solides.
Enseignante parallèlement à ses fonctions curatoriales, Daria de Beauvais insiste sur l’importance de la transmission et du mentorat dans son parcours, mais aussi sur l’ouverture et la curiosité. « Construire son regard, se faire un œil : ce sont des jalons essentiels du métier de curateur », résume-t-elle. Elle a répondu à mes questions.
Daria de Beauvais est historienne de l’art, curatrice, autrice et enseignante. Actuellement Curatrice Senior et Responsable des relations internationales au Palais de Tokyo, elle y a été commissaire ou co-commissaire de nombreuses expositions, dont récemment : Raphaël Barontini (2025), Myriam Mihindou (2024), « Dislocations » (2024), « Doppelganger ! » (2023), Marie-Claire Messouma Manlanbien (2023), « Réclamer la terre » (2022), Mimosa Echard (2022), Jonathan Jones (2021), « Anticorps » (2020). Elle a participé à plusieurs grands événements d’art contemporain : 15e Biennale de Lyon (co-commissaire, 2019), 49e Rencontres d’Arles (commissaire invitée, 2018), Nuit Blanche (commissaire associée, 2016), Expo Chicago (section vidéo, 2016). Elle enseigne la pratique de l’exposition dans le Master 2 professionnel « Sciences et techniques de l’exposition » à l’université Panthéon-Sorbonne et est co-responsable avec Morgan Labar du séminaire « Autochtonie, hybridité, anthropophagie » au département Arts de l’École normale supérieure (Paris).

Vue d’exposition, Thao Nguyen Phan, «Le soleil tombe sans un bruit», Palais de Tokyo (Paris), 12.06-07.09.2025Courtesy de l’artiste & ZINK Gallery (Allemagne) Crédit photo: Aurélien Mole
Marie de la Fresnaye. A quand remonte votre découverte de l’artiste ?
Daria de Beauvais. Il m’est difficile de dater cette rencontre de manière précise, mais ce que je peux souligner c’est la première collaboration du Palais de Tokyo avec Thao Nguyen Phan lors de la 15ᵉ Biennale de Lyon, dont notre équipe curatoriale assurait le commissariat. Cette invitation nous avait permis d’entrer dans son univers singulier, et nous avons eu envie de prolonger ce dialogue. C’est ainsi que quelques années plus tard, nous avons choisi de lui consacrer une exposition monographique au Palais de Tokyo, lui permettant de déployer toute la richesse de sa démarche.

Vue d’exposition, Thao Nguyen Phan, «Le soleil tombe sans un bruit», Palais de Tokyo (Paris), 12.06-07.09.2025Courtesy de l’artiste & ZINK Gallery (Allemagne) Crédit photo: Aurélien Mole
MdF. De nouvelles productions ont été engagées à cette occasion : quels partis pris vous ont-ils guidés ?
DdB. Sur la trentaine d’œuvres présentées, un tiers sont des productions inédites, réalisées spécialement pour l’exposition. Dès le départ, notre intention était de concevoir une exposition construite autour de plusieurs axes thématiques, qui permettent de mettre en lumière les différentes strates de la pratique de Thao Nguyen Phan, tant sur le fond que sur la forme.
L’un des partis pris essentiels a été de mettre en avant l’histoire croisée du Vietnam et de la France, afin d’ancrer cette invitation dans le contexte spécifique du Palais de Tokyo, institution française ouverte sur le monde. L’artiste explore ainsi des épisodes historiques allant du XVIIᵉ au XXᵉ siècle, tout en tissant un dialogue avec l’histoire de l’art. Un exemple fort de ce travail de mise en relation : la figure de Diem Phung Thi, artiste moderniste vietnamienne (1920-2002) sur laquelle Thao mène des recherches depuis plusieurs années. Elle a d’ailleurs déjà présenté une partie de ce projet au Pirelli HangarBicocca à Milan en 2023 et à la Kunsthal Charlottenborg à Copenhague en 2024.Ce dialogue intergénérationnel et transhistorique s’enrichit aussi de la présence de l’artiste contemporain Truong Cong Tung, invité à présenter deux œuvres en résonance.

Vue d’exposition, Thao Nguyen Phan, «Le soleil tombe sans un bruit», Palais de Tokyo (Paris), 12.06-07.09.2025 Courtesy de l’artiste & Galerie ZINK (Allemagne) Crédit photo : Aurélien Mole
MdF. Le terme d’amnésie politique est récurrent chez l’artiste
DdB. La question de l’amnésie, de la mémoire et du récit officiel est au cœur de sa démarche. Thao Nguyen Phan s’attache à interroger ce qui est occulté, oublié ou effacé par les versions dominantes de l’histoire. Mais elle le fait avec une grande subtilité, en tissant des narrations alternatives, souvent poétiques, qui s’écartent volontairement de l’Histoire avec un grand H. Ce qui l’anime, c’est la possibilité de faire émerger d’autres voix, issues de la vie quotidienne, du folklore, de la tradition orale,de la littérature.

Vue d’exposition, Thao Nguyen Phan, «Le soleil tombe sans un bruit», Palais de Tokyo (Paris), 12.06-07.09.2025 Courtesy de l’artiste & Galerie ZINK (Allemagne) Crédit photo : Aurélien Mole
MdF. Un nouveau corpus de l’exposition s’articule autour de la figure du missionnaire et ethnologue Jacques Dournes. Qu’est-ce qui a retenu l’attention de Thao Nguyen Phan dans cette histoire ?
DDB. Thao Nguyen Phan a entamé des recherches sur Jacques Dournes (1922-1993), missionnaire et ethnologue français ayant longuement vécu dans la région des Hauts Plateaux, au centre du Vietnam, auprès de la population Jaraï. Ce territoire revêt une signification particulière pour l’artiste, car c’est également la région d’origine de son mari, l’artiste Truong Cong Tung, invité dans l’exposition. Plusieurs de leurs œuvres sont liées à cet héritage géographique et culturel.
L’artiste s’est intéressée à ses archives, aujourd’hui conservées en grande partie à l’IRFA (Institut de recherche France-Asie), ainsi qu’au Musée du quai Branly, notamment pour les documents photographiques. Nous avons établi un dialogue avec ces deux institutions afin d’obtenir l’accès aux archives numérisées, sur lesquelles Thao a pu s’appuyer pour développer ce nouveau corpus, un travail d’aquarelle sur diapositives.
MdF. Un autre personnage historique traverse l’exposition : le prêtre jésuite Alexandre de Rhodes, à l’origine de l’œuvre Voyage de Rhodes. Pourquoi avoir intégré cette œuvre dans le parcours ?
DdB. Voyage de Rhodes est une œuvre préexistante, une œuvre majeure de l’artiste, que nous avons souhaité inclure car elle élargit encore davantage le spectre historique exploré par Thao Nguyen Phan. Elle y convoque la figure d’Alexandre de Rhodes, missionnaire jésuite qui a parcouru l’Asie au XVIIᵉ siècle, en retravaillant à l’aquarelle un fac-similé de ses récits de voyage. S’il est connu pour sa mission d’évangélisation, il a aussi joué un rôle crucial dans la romanisation de la langue vietnamienne, un processus qui ne s’achèvera qu’au XIXᵉ siècle, au moment de la colonisation française. Ce choix permet à l’artiste de croiser différentes strates de l’histoire coloniale et linguistique du Vietnam.
Thao Nguyen Phan, A Humble Cottage, extrait de Palm-of-the-Hand Moving Image, 2024 – en cours, photogramme. Courtesy de l’artiste et Galerie Zink (Allemagne). Crédit photo : Thien Truong
MdF. La vidéo Reincarnations of Shadows prend une nouvelle ampleur dans l’exposition avec un dispositif multi-écrans particulièrement immersif.
DdB. Effectivement, cette installation vidéo originellement conçue pour deux écrans a été déployée par l’artiste sur cinq écrans, avec l’ajout de nouvelles images. Reincarnations of Shadows devient ici une pièce maîtresse de l’exposition, à la fois visuellement puissante et émotionnellement dense. Il s’agit d’un hommage à Diem Phung Thi, artiste vietnamienne moderniste au parcours singulier : installée en France de la fin des années quarante au début des années quatre-vingt-dix, elle fut d’abord dentiste avant de devenir artiste, dans une trajectoire personnelle intimement liée à l’histoire politique de son pays. La vidéo fait notamment référence aux Accords de Paris en 1973, qui marquèrent un tournant dans la guerre du Vietnam. La voix off lit des extraits du journal de Diem Phung Thi, tissant un récit où se mêlent la petite et la grande Histoire, dans une narration à la fois sobre et profondément incarnée.
Cette œuvre constitue pour moi l’un des sommets de la pratique de Thao Nguyen Phan. Le titre, Reincarnations of Shadows, entre en résonance directe avec celui de l’exposition, « Le soleil tombe sans un bruit », emprunté à un recueil de Yasunari Kawabata, écrivain japonais et prix Nobel de littérature, que l’artiste cite parmi ses influences. Il y a cette même volonté de révéler des pans oubliés ou négligés de l’histoire, mais toujours dans une forme de clair-obscur : un équilibre entre lumière et ombre, où rien n’est jamais tout à fait tranché, ni entièrement lisible.
MdF. Les femmes occupent une place importante dans cette saison du Palais de Tokyo. On sent d’ailleurs des correspondances subtiles entre les univers de Thao Nguyen Phan et de Vivian Suter. Était-ce une volonté affirmée ?
DdB. C’est une orientation que nous cultivons de manière consciente mais non systématique. Nous cherchons à construire des saisons qui aient du sens et de la cohérence, certaines correspondances se dessinent que le public peut capter librement.
Dans le cas de Thao Nguyen Phan et Vivian Suter, il existe effectivement des échos sensibles entre leurs œuvres, bien que leurs démarches soient très différentes sur le plan formel. La nature y tient une place centrale, mais pas comme simple décor ou sujet : elle est une force active au cœur même de leurs pratiques. Chez l’une comme chez l’autre, il y a cette même volonté de laisser une place à la sensation, à l’intuition, à une forme de perception organique du monde.

Vue d’exposition, Vivian Suter, «Disco », Palais de Tokyo (Paris), 12.06-07.09.2025Copyright Vivian Suter Courtesy de Karma International, Zurich; Gladstone, New York / Bruxelles / Séoul; Gaga, Mexico DF; Proyectos Ultravioleta, Guatemala City Crédit photo: Aurélien Mole
MdF. Quel est votre rôle au quotidien en tant que curatrice senior et responsable des relations internationales au Palais de Tokyo ?
DdB. Ce qui me porte au quotidien, ce sont les artistes. Je les considère comme des vigies, capables de percevoir ce qui se profile à l’horizon, de poser un regard à la fois lucide, sensible et engagé sur le monde. Leur travail est, à mes yeux, une forme d’engagement social et politique, et c’est cette dimension qui m’anime depuis le début de ma carrière.
Mon rôle de curatrice senior, au-delà de la programmation artistique de l’institution, repose sur l’accompagnement des artistes dans la durée. C’est pour cela que je privilégie souvent les expositions personnelles aux projets collectifs : elles permettent de construire un véritable dialogue au long cours, de tisser une relation de confiance, que je poursuis parfois à travers d’autres formes de collaboration : écriture de textes, soutien à des résidences, visites d’atelier… Les artistes ont besoin d’interlocuteurs engagés et présents, au-delà du seul temps d’une exposition.
Mon engagement est aussi institutionnel. Cela fait plusieurs années que je travaille au Palais de Tokyo, une institution que je considère comme à part, laissant aux artistes un espace d’expérimentation rare. En tant que responsable des relations internationales, je m’attache aussi à développer les réseaux du Palais à l’étranger, à favoriser son rayonnement et ses collaborations, forte d’un parcours personnel qui s’est toujours inscrit dans une dynamique internationale. Même si Paris s’enrichit d’années en années en fondations, musées et lieux d’art, le Palais de Tokyo conserve, selon moi, une place unique et précieuse dans le paysage culturel.
MdF. Vous avez récemment été ambassadrice du Paris Gallery Weekend. Quel regard portez-vous sur le rôle des galeries ?
DdB. Je le dis souvent à mes étudiants que l’art contemporain est un écosystème, et comme dans tout écosystème, tout est interdépendant. Il est vain d’opposer les institutions au marché de l’art, comme s’il s’agissait de deux mondes étanches. Tout dialogue, tout s’entrelace, et les galeries jouent un rôle essentiel dans cette dynamique.
J’ai eu l’occasion de travailler en galerie en France, en Italie, aux États-Unis, et je peux témoigner que, bien au-delà des enjeux commerciaux, les galeries s’inscrivent dans un véritable compagnonnage avec les artistes. Elles les soutiennent sur le long terme, accompagnent leur développement, participent à leur visibilité, à leur présence dans les foires, les collections, les institutions.
MdF. Quelles personnes ont été décisives dans votre parcours de curatrice ?
DdB. Pour moi, ce sont avant tout les artistes qui ont joué un rôle tutélaire, même lorsque je n’ai pas travaillé directement avec eux. Dès mes études en histoire de l’art, j’ai été marquée par la pratique d’artistes telles que Cindy Sherman, Sophie Calle ou Rebecca Horn, puis plus tard par Louise Bourgeois ou Ana Mendieta. Travailler avec des artistes femmes a donc été pour moi, de façon à la fois intuitive et naturelle, une forme d’engagement. Au fil des années, ce positionnement est devenu un véritable fil conducteur de ma démarche.
Quant aux personnes qui ont compté dans mon parcours, elles ont été nombreuses et il serait difficile de toutes les citer. Ce que je tiens à souligner, c’est l’importance de donner leur chance aux jeunes générations, de s’investir dans la transmission et le mentorat. C’est une valeur dont j’ai bénéficié et que j’essaie de mettre en pratique aujourd’hui, à mon échelle. Je crois profondément que chacun porte une pensée, un regard singulier, et que cela ne dépend ni de l’âge ni de l’expérience. Chaque voix mérite d’être entendue et accompagnée.
MdF. Quels conseils donneriez-vous à de futurs curateurs ?
DdB. Mon premier conseil, et peut-être le plus important, c’est de se faire l’œil. Voir, regarder, s’immerger dans un maximum d’expériences : expositions, ateliers d’artistes, performances… C’est un apprentissage quotidien.
A l’époque où il dirigeait le Palais de Tokyo, Jean de Loisy m’avait dit que j’avais un très bon œil. Cela m’avait touchée, car le regard, ce n’est pas qu’une question de goût personnel, même si la subjectivité fait partie intégrante de la pratique curatoriale. C’est plutôt une capacité à reconnaître la qualité d’un travail artistique, au-delà des premières impressions. Pour cela, il faut être capable de sortir de ses réflexes, de rester curieux et ouvert d’esprit, toujours prêt à découvrir ce qui nous surprend, ou nous questionne.
Infos pratiques :
Thao Nguyen Phan
« Le soleil tombe sans un bruit »
Nouvelles expositions du Palais de Tokyo
Jusqu’au 9 septembre