Rousselet à bicyclette – lecture de bas en haut et de gauche à droite. Chronophotographie sur
bande mobile : aristotype à partir d’un négatif sur film celluloïd, 1893. Université Paris Cité –
BU STAPS
Directrice du pôle patrimoine, culture et rayonnement scientifique de l’Université Paris-Cité, Agathe Sanjuan est la commissaire de l’exposition « Étienne-Jules Marey : chronophotographie, sciences et art », l’un des temps forts de l’édition PhotoSaintGermain 2025. Pionnier de techniques photographiques qui annoncent le cinéma comme la chronophotographie, Marey (1830‑1904) est un scientifique dont les avancées touchent des domaines aussi divers que : l’aviation, l’anthropologie, la phonétique, le sport ou les sciences du travail, un volet de son influence encore assez méconnu. Si ses images continuent de fasciner, ses découvertes scientifiques n’avaient pas fait l’objet d’une véritable exposition. Agathe Sanjuan revient sur les méthodes employées par Marey dans ses différents laboratoires, son ouverture d’esprit, ses liens avec Muybridge et son approche académique très atypique. Les photographies ou les graphes de Marey sont d’une grande modernité et ont inspiré toute une avant-garde artistique comme elle le souligne. En plus des partis pris qui l’ont guidé autour de cette exposition, elle nous présente également la publication qui accompagne et prolonge ce projet.

Portrait d’Agathe Sanjuan, Directrice du pôle patrimoine, culture et rayonnement scientifique de l’Université Paris-Cité, Commissaire de l’exposition « Étienne-Jules Marey : chronophotographie, sciences et art »
Marie de la Fresnaye. Tout d’abord, revenons à ce que veut dire chronophotographie ?
Agathe Sanjuan. La chronophotographie, est un principe en photographie qui prend en série, de manière rapprochée, régulière et à partir d’un même point de vue, une série de photographies replaçant la photographie dans une continuité spatio-temporelle.
MdF. En quoi le procédé était-il révolutionnaire et en quoi Marey se distingue-t-il de Muybridge ?
AS. C’est un procédé révolutionnaire parce que jusqu’à cette période-là, on connaît l’instantané, mais on ne connaît pas la prise de vue du mouvement. C’est vraiment cela que vise la chronophotographie. En ce qui concerne à EadweardJames Muybridge, ils ont été très proches avec Marey, ont correspondu et se sont tenus au courant très étroitement des avancées de leurs techniques respectives. Marey est très reconnaissant et enthousiaste envers Muybridge et ses expérimentations autour de la photographie des allures d’un cheval à partir d’un dispositif de 12 appareils photographiques qui le long d’une piste, sont déclenchés par le passage du cheval brisant successivement les fils reliés aux obturateurs avec leurs pattes, ce qui déclenche un nouveau cliché. Mais Marey souhaite aller plus loin autour d’un point de vue unique à partir de l’observation du vol d’un oiseau. C’est ce qu’il va inventer à travers son premier appareil qui est le fusil chronophotographique.

Étienne-Jules Marey (concepteur), Charles Verdin (constructeur). Cylindre enregistreur de
Marey avec régulateur de Léon Foucault. Laiton, fonte, 1889. Université Paris Cité – Institut
de Pyschologie.
MdF. Quelles sont les ambitions de cette exposition ?
AS. L’idée de l’exposition, c’est de montrer que Marey est avant tout un chercheur en « science pure », selon la terminologie de l’époque, c’est-à-dire en recherche fondamentale, et qu’il a essaimé dans de très nombreux domaines autour de lui. Il était extrêmement généreux. Il laissait l’usage de ses instruments, de ses laboratoires, de ses dispositifs et de ses résultats à d’autres chercheurs qui, eux, avaient des visées applicatives, utilitaires.
MdF. Des visées plus commerciales ?
AS. Plus commerciales, ou pas, mais en tout cas utilitaires.
Marey poursuivait un unique objectif, celui de saisir le mouvement, de comprendre comment il fonctionne, de le synthétiser même, de le modéliser. Des recherches qui ont ouvert la voie à des applications extrêmement nombreuses, que ce soit l’entraînement des militaires, l’entraînement des enfants à l’école avec la gymnastique, l’entraînement des sportifs, l’anthropologie, les questions de lecture labiale, de phonétique, ce que l’on a appelé plus tard, la science du travail autour du geste artisanal, l’aviation…Des avancées qui dépassent complètement son projet à l’origine.

Vue de l’exposition « Étienne-Jules Marey : chronophotographie, sciences et art » au Musée d’Histoire de la Médecine
MdF. Vous ne faites pas l’impasse sur le lien avec l’anthropologie raciale
AS. À cette époque-là, l’anthropologie est une anthropologie raciale qui s’inscrit véritablement dans la lignée du darwinisme. On estime que les races humaines sont soumises au même principe de l’évolution que les animaux et qu’il existe par conséquent des races supérieures à d’autres. Avec comme présupposé que la race supérieure est la race blanche. L’ensemble de l’anthropologie de cette époque travaille dans cette perspective-là. Marey en réalité va laisser l’usage de son laboratoire à des chercheurs qui font des comparaisons de ce type dans des buts bien précis. Marey ne souhaite pas montrer de supposées différences raciales à proprement parler mais certains de ses collaborateurs utilisent ce présupposé dans des buts bien précis, par exemple pour améliorer la marche et la course du soldat, éviter la fatigue…
MdF. Comment avez-vous fait pour rassembler toutes ces images à partir de fonds très éclatés ?
AS. On est partis de notre fonds à l’Université Paris-Cité qui est conservé à la bibliothèque de STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), dans la mesure où cela concerne l’enseignement du geste du sport. A partir du moment où j’ai étudié ce fonds, petit à petit, s’est dessiné un fil rouge autour de ce qui provenait de Marey et ce qui provenait de ses collaborateurs. Ce lien entre la science pure et les sciences appliquées. J’ai alors cherché des pièces complémentaires dans d’autres fonds, principalement au Collège de France, au Musée des Arts et métiers, à la Cinémathèque française, à l’INSEP, à la Bibliothèque de l’hôtel de Ville de Paris ou auprès de prêteurs privés. Des fonds qui complétaient cette réflexion.
MdF. Combien de temps a pris ce projet ?
AS. Un an ½
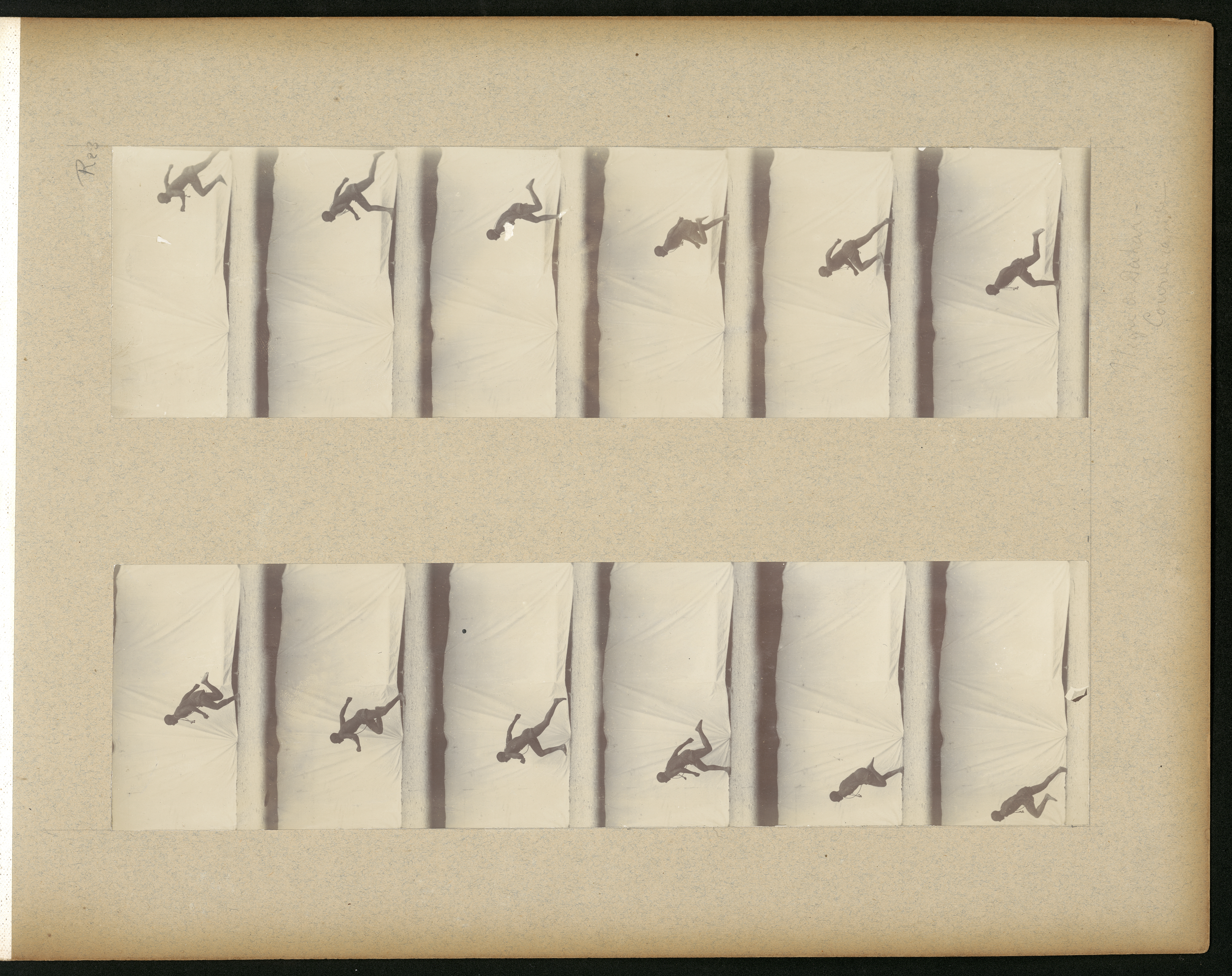
Laboratoire Marey. Course rapide. Chronophotographie sur bande mobile : aristotype à partir
d’un négatif sur film celluloïd, 1895. Université Paris Cité – BU STAPS
MdF. En ce qui concerne les laboratoires de Marey, où se trouvaient-ils ?
AS. Il en a eu plusieurs en effet. Il en a eu un premier rue-Cuvier dans le 5ème. Ensuite, il en a eu un, rue de l’ancienne Comédie, dans l’ancienne salle de théâtre de la Comédie-Française au XVIIIe siècle, qui disposait de volumes très importants. Il pouvait notamment faire voler des oiseaux. Ensuite, il a eu un laboratoire au Collège de France quand il a été nommé professeur dans cette institution. Mais son vrai laboratoire, c’est la Station physiologique du Parc des Princes, qui est un très grand espace aménagé spécifiquement pour ses expériences de physiologie et biomécanique, avec deux pistes de course, l’une pour les chevaux, l’autre pour les hommes, des hangars, des écrans devant lesquels il pouvait faire évoluer des animaux ou des hommes. C’est un ensemble transdisciplinaire à la croisée d’un laboratoire, d’un gymnase, d’un zoo… qui fascine nombre de ses contemporains.
MdF. En quoi Marey va-t-il inspirer de nombreux artistes ? On pense à Duchamp notamment
AS. Ces images inspirent les artistes parce que ce sont des visions fragmentées de la réalité, avec comme continuité possible tout le lien que l’on peut faire avec certains courants comme le constructivisme, le futurisme… C’était une véritable réinvention de l’image qui continue à fasciner les artistes, aujourd’hui encore.
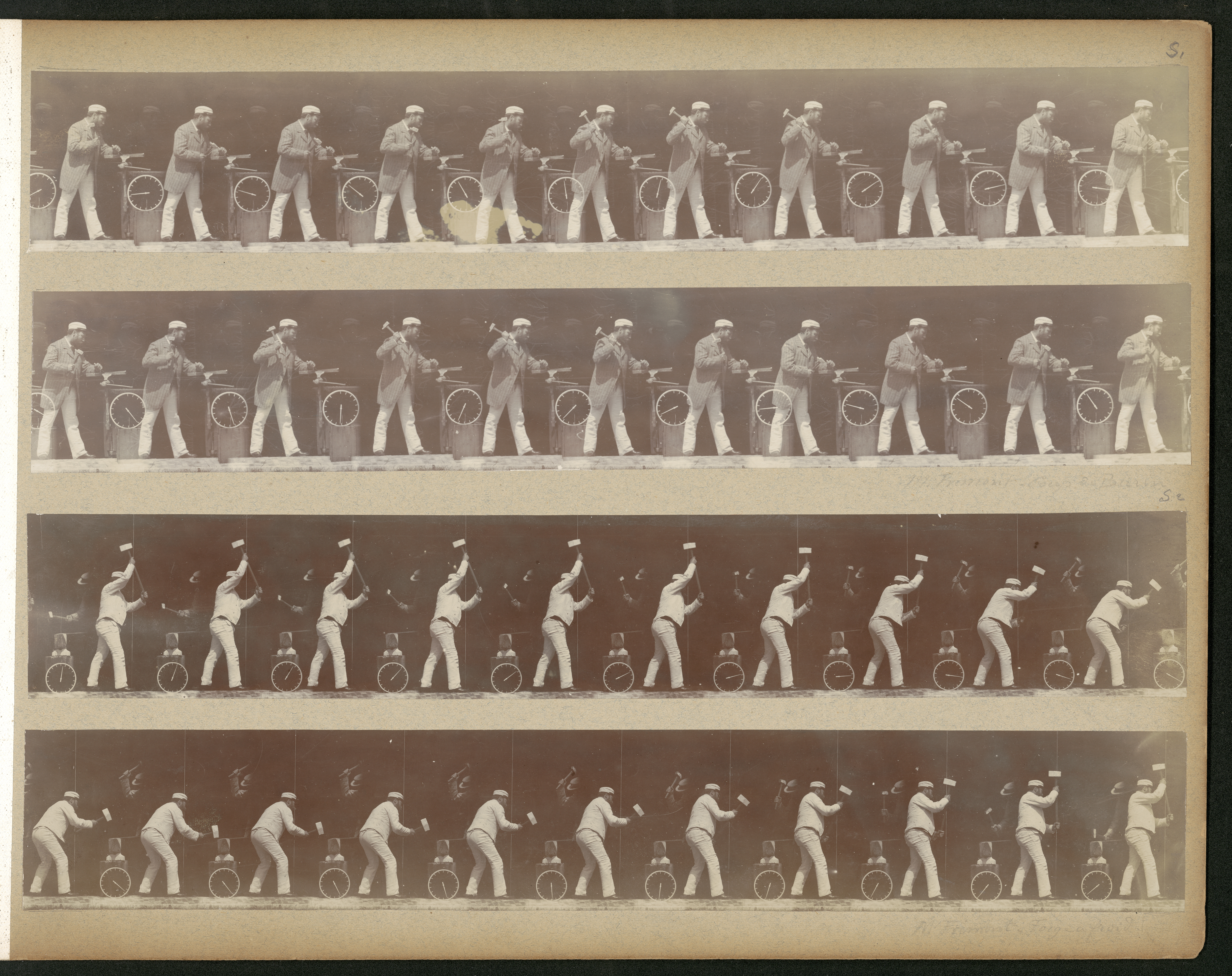
Laboratoire Marey. M. Frémont – Coup de Burin / M. Frémont – Forge à froid.
Chronophotographie sur bandes mobiles : aristotypes à partir de négatifs sur film celluloïd,
1894. Université Paris Cité – BU STAPS
MdF. Marey a-t-il laissé des traités importants, des ouvrages qui font référence encore aujourd’hui ?
AS. Marey a énormément publié, beaucoup d’articles dans des périodiques, dans des revues. Des travaux qui ont été dépassés sur le plan scientifique. Tandis que les artistes, eux, se sont toujours attachés à ces images qui restaient esthétiquement extrêmement intéressantes.
MdF. Marey anticipe-t-il réellement le cinéma ?
AS. Marey est considéré comme l’un des précurseurs du cinéma parce qu’il a mis en œuvre la chronophotographie sur une bande pelliculaire. Cela marque clairement le début du cinéma. Même s’il n’a que des visés scientifiques et n’a jamais cherché à avoir une restitution de la réalité, ce que cherche le cinéma en partie. D’autre part, il n’a pas de vision narrative des images et ne cherche pas à raconter des histoires. En cela il n’est pas du tout dans l’approche du cinéma. Et même s’il lui est arrivé de faire des projections, la projection à vitesse réelle ne l’intéresse pas. Il veut pouvoir varier les vitesses, justement, pour pouvoir contribuer à l’analyse du mouvement.
MdF. L’exposition s’accompagne d’une publication : pouvez-vous nous la présenter ?
AS. C’est un livre qui comporte une dizaine d’essais sur des sujets très spécifiques. Nous commençons par un article biographique par Andréa Barbe-Hulmann (responsable du Musée d’histoire de la médecine), un article sur les appareils et instruments de Marey par Serge Nicolas, professeur de psychologie et une histoire des Fonds Marey par Claire Guttinger, archiviste du Collège de France.
Dans une deuxième partie sur le vivant est proposé un article sur la vulgarisation chez Marey d’Agnès Sandras, conservatrice à l’Université Paris-Cité. Un article sur les liens entre l’observation du vol des oiseaux et les prémices de l’aviation par Ion-Gabriel Mihailescu, chercheur à l’université de Neuchâtel. Une troisième partie se penche sur les domaines d’applications des recherches de Marey avec un volet sur l’éducation physique et Marey par Bernard Andrieu, professeur d’université en STAPS, Université Paris Cité, Marion Leuba conservatrice des musées de Beaune et Ana Cristina Zimmermann, professeur Université de São Paulo, Brésil. Et enfin la question de la race chez Marey par Marta Braun, une des spécialistes de son œuvre.
Dans une dernière partie sur les arts, Michel Frizot revient sur l’esthétique de la chronophotographie, pour terminer par le point de bascule entre l’analyse et la synthèse du mouvement chez Marey par Guigone Rolland, historienne de l’art.
Ce qui fait l’originalité de l’ouvrage repose sur ces différents essais mais également un très grand nombre d’images qui sont très légendées. L’idée est d’analyser ces images qui restent quand même parfois difficiles à lire pour le public aujourd’hui. On ne les comprend pas forcément, au-delà de leur beauté. Savoir quelles peuvent être leurs significations dans leur époque est ce que l’on a essayé de faire avec ce livre.
Infos pratiques :
« Étienne-Jules Marey : chronophotographie, sciences et art »
Musée d’Histoire de la Médecine – Université Paris Cité
12 rue de l’École de Médecine, 75006 Paris
Ouvert du lundi au samedi, de 14h à 17h30
Catalogue coédition Université Paris Cité x PhotoSaintGermain, 143 pages, 20 euros
https://www.photosaintgermain.com/editions/2025/parcours/musee-dhistoire-de-la-medecine







