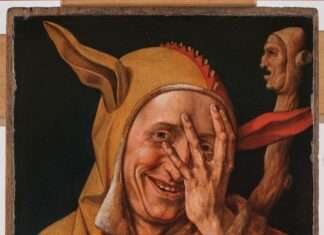Anne Guérain Vue de l’installation « Acanthes », Exposition Double Trouble, Art Emergence Artagon © Manuel Abella
Parmi les 42 jeunes artistes diplômé·es des écoles publiques d’art et de design françaises réunis par Artagon pour la première édition d’Art émergence sous le commissariat de : Salomé Fau, Alexis Hardy et Temitayo Olalekan, l’installation d’Anne Guérain dans les Réserves du Frac m’interpelle. Cette baignoire constituée d’une sorte de machinerie hydraulique qui renvoie à un paysage suspendu mais aussi à la mort de Marat.. et le titre, « Acanthes »en lien avec l’histoire de l’ornementation Antique. Tout un faisceau d’influences que l’on devine. Anne Guerain qui conjugue pratique artistique et soins prodigués en tant qu’infirmière de nuit, évoque ce passage entre la nuit et ses terreurs et l’aube des recommencements de l’art à partir de la pensée d’Audre Lorde, la place de l’intime face à cette mise à nu, la résistance des femmes en perte d’autonomie et sa propre résistance en tant qu’artiste, femme et mère. Anne poursuit des recherches en art-thérapie et dans le cadre de son DSRA (diplôme supérieur de recherche en art) à l’ESAAA va s’orienter autour de la part des récits et du sentiment dans le soin. Une pensée agissante.
Comment avez-vous entendu parler d’Art émergence par Artagon ?
Je suis diplômée de l’ESAAA (école d’art d’Annecy Alpes) et nous avons accès après le diplôme à une mailing list avec le publipostage d’informations concernant des résidences d’artistes, des appels à candidatures pour certains évènements comme Art Emergence.
Je connaissais Artagon et la qualité du travail mené par Anna Labouze et Keimis Henni; leur vision inclusive, accessible et populaire de l’art et la culture me parle. J’ai candidaté à Art Emergences et j’ai eu la chance d’être retenue.

Anne Guérain Vue de l’installation « Acanthes », Exposition Double Trouble, Art Emergence Artagon © Manuel Abella
Vous proposez l’installation « Acanthes » dans les réserves du FRAC IdF: qu’est-ce qui se joue ?
Acanthes est une pièce plurielle que j’ai réalisé au cours de mes deux années de master Art. C’est la pièce initiale de mon exposition de DNSEP depuis laquelle d’autres formes, d’autres pistes de travail sont nées. Les trois acanthes représentées peuvent être abordées selonplusieurs niveaux de lecture (du plus trivial au plus historique). L’acanthe en tant que forme d’étude (L’acanthe corinthienne est la forme récurrente de l’ornement antique dans l’histoire de l’art occidental) est apparue depuis une réflexion personnelle sur l’ornement que j’ai ouverte lors de l’écriture de mon mémoire de Master « Ornement, organographie et affects ». Ce sont au départ des reproductions de bas-reliefs d’acanthes de l’antiquité gréco- romaine, réellement exposés au musée du vatican sur lesquels j’ai travaillé après les avoir vu une première fois et avoir vécu une sorte de choc esthétique, un « empourprement » pour reprendre une expression d’Audre lorde. J’ai ensuite poussé les formes dans leurs retranchements en les agrandissant pour en bousculer les codes – j’aime à dire que toute une part de ma pratique consiste à mettre l’ornement en crise. Dans la pièce, les acanthes représentent à un autre niveau trois pleureuses qui actent un endeuillement, elles expriment le chagrin, en larmes elles se lamentent au-dessus d’un corps que j’ai imaginé comme étant leur propre matrice. Une mère aurait enfanté ses propres pleureuses pour sa cérémonie funéraire. Dans l’antiquité et plus tard, les pleureuses ont toujours joué un rôle d’intermédiaire, d’intercesseur ritualisé ainsi qu’un rôle fédérateur visant à souder dans l’épreuve la communauté mise à mal. Elles ont le droit de se laisser aller à toutes les extravagances du désespoir. Leur liberté me touche car celle-ci a souvent été envisagée comme « hystérique ». A un certain niveau ce sont aussi des systèmes urinaires, génitaux, vulvaires libérés et devenus autonomes, ce sont aussi des machineries improbables, hybrides perfusées de tuyaux, un mode de langage lacrymal.
Acanthes, c’est aussi une pièce très formelle de sculpture avec des notions de tensions entre l’élévation des trois formes suspendues et leur pesanteur. L’horizontalité hors-normes de la baignoire qui voudrait s’étendre encore davantage et le cadrant métallique qui la contient. C’est aussi une pièce de peinture car les acanthes sont des peaux de plâtre que j’ai peint avec de la terre et qui sont des masques comme des masques de cérémonie funéraire, masque de pleureuse. J’ai une pratique qui tente de réconcilier la peinture et la sculpture. Dans cette pièce j’ai interrogé l’acanthe corinthienne et aussi les matériaux comme le plâtre, matériau de contact, de la duplication et du moulage mais aussi de la réparation dans les soins, la paraffine pour ses qualités imperméables et esthétiques qui évoquent le marbre de la piéta de Michel-Ange à Rome, qui renvoie aussi à la mater dolorosa.
J’aime jouer avec des symboles de l’histoire de l’art et les poussés à bout. La baignoire c’est aussi avec les plis de tissus la baignoire de la mort de Marat. Une baignoire où on se lave et où on meurt assassiné. C’est aussi le ventre maternel duquel on voudrait s’extraire et duquel on est toujours attaché.
Pour l’exposition Double Trouble, Acanthes est exposée dans les réserves du Frac Ile de France au rez-de-chaussée devant la baie vitrée en présence des oeuvres de Baptiste Thiebaut Jacquel et Cassandra Delpy. Dans cette configuration d’installation, les acanthes m’évoquent aussi des sortes de fleurs-champignons, l’enfance et une sorte de rêverie champêtre.
Artiste et infirmière : comment votre action de soin au quotidien influence votre pratique artistique ?
Je suis une passeuse dans les deux cas. En tant que soignante et infirmière de nuit, j’ai sous ma responsabilité des vies, des personnes en souffrances avec des trajectoires personnelles multiples, je suis garante du secret professionnel. Ma mission la nuit est de faire passer les soigné·es le plus doucement possible, le plus tranquillement possible de la nuit sombre avec ses terreurs jusqu’au jour qui se lève. Je me suis penchée sur l’impact que pouvait avoir ses rencontres avec ses autres vies, ses situations de contact sur ma vie intérieure, mes fantasmes, mes rêves. Quelle mémoire je peux conserver de ces rencontres qui me bouleversent et nourrissent mon imaginaire et donc mon art. Je suis témoin de tant de mises à nu, de perte d’intimité qui ne peuvent se raconter. l’expression artistique me permet de révéler ce qui me touche dans ces rencontres humaines, de donner du sens à ce qui est secret et ce qui mérite d’être entendu et partagé. Par exemple tout un pan de mon travail porte sur la visibilisation des femmes à l’apogée de leur vie, en situation de perte d’autonomie et vivant en institution pour personnes âgées dépendantes.
Dans mes gestes artistiques il y a aussi des gestes soignants de réparation vis à vis de la perte, de la blessure, de la cassure. Acanthes évoque l’art du pansement, avec l’utilisation des bandes plâtrées, du colmatage avec la paraffine. Les gestes du toucher et de la précision chirurgicale se ressentent plus dans ma manière de peindre les portraits. Il y a aussi beaucoup l’idée de la peau, de l’épiderme dans mon travail. Et puis il y a le côté très organique de mes pièces, les fluides, les sécrétions, le rapport au corps qui se dégrade mais résiste en tant qu’élan vital.
Votre projet de diplôme reprend un vers de la poétesse et militante Audre Lorde : en quoi sa pensée de l’empowerment vous inspire ?
L’empowerment selon Audre Lorde, c’est l’autonomie de la femme pensée comme résistance de l’intime dans un mode d’expression créatif celui de l’éros, entendu comme recherche d’équilibre entre l’action et le sentiment. Pour Audre Lorde, la réconciliation entre le spirituel et le politique passe par l’érotique. Pour une femme c’est s’affirmer dans son plaisir à être malgré les injonctions qui nous brident qui voudraient nous invisibiliser, nous réduire à un silence poli et une délicatesse mesurée. C’est être en contact avec sa racine érotique. Je suis moi-même dans une position de résistance, résistance de mon corps à l’exigence de mon travail infirmier la nuit, résistance à être une femme artiste, résistance de mon identité intime de mère, de femme mature, de mon éros qui s’exprime dans mon travail artistique, résistance de mon corps et jouissance de celui-ci à aimer la montagne, à aimer courir sur des longues distances, à porter, à vouloir assurer mon autonomie et l’indépendance de ma fille, ma survie sans homme à mes côtés.
Audre Lorde a mis des mots sur des pensées qui m’habitent depuis l’enfance. Par ailleurs j’admire la pensée lesbienne, cette prise de liberté vitale. Dans mon projet de diplôme « Entre deux aubes » j’évoque le passage psychique que j’effectue entre ce que j’appelle « la nuit des soins » et le début du jour de l’art, les instants frottés et les rencontres qui agissent comme des lumières. Le spectateur est accueilli par une forêt de pieds à sérums avec des peintures à l’huile de tartelettes de fraise, qui figurent la fête et l’organe cardiaque. Au verso de chacune il y a un vers du poème Lithanie pour la survie. C’est ce poème d’Audre Lorde qui fait lien entre les différentes pièces de mon exposition de DNSEP.
Quelles ont été les étapes décisives de votre parcours ?
J’ai commencé mes études supérieures en 1990 en faculté d’histoire de l’art que j’ai vite abandonné pour me tourner résolument vers une pratique artistique plasticienne. Je suis entrée aux Beaux-arts de Grenoble à 19 ans pour sortir de ceux de Marseille à 24 ans en cinquième année. J’ai arrêté l’école avant de valider le diplôme car je ne trouvais plus de sens à mes études aux beaux-arts. J’avais besoin d’un autre type de contact avec l’art et envie de rencontrer d’autres cultures, d’ouvrir ma pratique et la rendre voyageuse. Je suis donc partie vivre au Maroc où j’ai mené plusieurs projets personnels en photographie dans les montagnes de l’Atlas et rencontré le père de mon enfant. J’ai aussi eu l’opportunité de me former à la photographie argentique couleur au centre VU à Québec pendant plusieurs mois.
De retour en France je suis revenue dans ma région natale en Haute Savoie car les montagnes me manquaient et je voulais être mère. Je suis devenue soignante, aide d’abord puis infirmière. J’ai eu ensuite mon enfant. Pendant ces années loin du milieu de l’art, j’ai maintenu mon activité artistique par des carnets, des prises de notes et une pratique journalière du dessin d’études et aussi beaucoup de lectures. Concernant ma pratique soignante je me suis orientée dans les soins palliatifs et formée aux thérapies non médicamenteuses, j’ai suivi une formation médicale universitaire en art-thérapie et une autre en hypnothérapie. J’ai passé une commission d’équivalence en 2021 à l’école des Beaux-arts d’Annecy pour entrer en cinquième année et valider mon DNSEP pour ensuite poursuivre sur de la recherche en art après le diplôme.
Je suis entrée en 4ème année de master Art en 2022. Le système ayant changé je devais écrire un mémoire et rétrograder d’un an mais cela m’a parfaitement convenu. Le retour dans une école d’art a été une étape décisive et incroyablement nourrissante.
Aujourd’hui mes projets se poursuivent dans la recherche ART/santé, je viens de terminer une résidence au LBO qui est un centre d’art monté au sein d’un Ehpad et soutenu par la scène nationale Malraux de Chambéry et je vais débuter un DSRA (diplôme supérieur de recherche en art) en février 2026 à l’ESAAA. Mon projet de recherche va creuser la part du sentiment et du romanesque dans le soin, les questions d’éthiques et les possibilités de récits que cela met en jeu. Je conserve toujours à temps partiel une activité d’infirmière de nuit car c’est aussi mon terrain de recherche artistique. In fine j’aimerais élaborer un langage atypique, commun à ces deux milieux que sont le soin et l’art.
Infos pratiques :
L’exposition Double trouble
Jusqu’au 2 novembre
Chaufferie de la Fondation Fiminco & Réserves du Frac Île-de-France
43 Rue de la Commune de Paris, Romainville
Entrée libre et gratuite
Festival / Maison des métallos
Parcours / 30 ateliers, collectifs d’artistes …