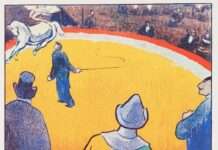Annabelle Lacour et Hoda Afshar (de gauche à droite) Exposition « Hoda Afshar. Performer l’invisible » proposée au musée du 30 septembre 2025 au 25 janvier 2026.© musée du quai Branly -Jacques Chirac, photo Mehrak Habibi
Avec l’exposition « Hoda Afshar Perfomer l’invisible », le musée du Quai Branly poursuit un travail de mise en valeur de la production contemporaine photographique non-occidentale comme le souligne son président Emmanuel Kasarhérou. Une première en France pour l’artiste iranienne, installée en Australie qui mène une recherche sur les mécanismes d’emprise idéologique de la photographie ethnographique coloniale, leur survivance et la représentation des femmes et du voile dans les productions orientalistes. Constituée en deux volets « Speak the Wind » (2015-2020) et « The Fold » (2023-2025) le parcours réveille des récits oubliés ou invisibilisés et entreprend une décolonisation des regards et des imaginaires. Parmi les collections du musée du Quai Branly, Hoda Afshar au fil de ses échanges avec Annabelle Lacour, s’est particulièrement intéressée au fonds Gaëtan Gatian de Clérambault, psychiatre et médecin colonial. Un personnage ambigu qui se livre à une étude du drapé traditionnel marocain et dont les clichés seront exposés en 1922 au pavillon du Maroc à l’Exposition coloniale de Marseille. Annabelle Lacour nous décrypte la méthodologie de l’artiste et les partis pris engagés autour de plusieurs médiums : une installation photographique, une installation de miroirs, une vidéo et une création sonore. Cette nouvelle version de « The Fold » a été produite et acquise par le musée du Quai Branly soulignant une volonté de soutien à la création contemporaine, matérialisée également par le Prix pour la Photographie. Annabelle Lacour revient sur la persistance du fonds Clérambault et l’impact qu’il continue d’exercer auprès de nombreux spécialistes, la pertinence de la réponse apportée par Hoda Afshar et les enjeux défendus par la politique d’acquisition du musée en corrélation avec les expositions. Elle a répondu à mes questions.
Annabelle Lacour est responsable de collections photographiques au musée du quai Branly-Jacques-Chirac. Elle a été co-commissaire des expositions Ouvrir l’album du monde, Photographies 1842-1911 (musée du quai Branly – Jacques Chirac, avril 2023), Habiter ce monde (musée Théodore Monod – IFAN, Dakar, janvier 2024) et Réenchanter nos vies (musée Théodore Monod – IFAN, Dakar, février 2025). Elle a été co-directrice de la publication Mondes photographiques, histoires des débuts, un ouvrage de référence sur l’histoire des débuts de la photographie en dehors de l’Europe réunissant 48 auteurs internationaux. Elle a co-dirigé le numéro 9 de Photographica « Photo-monde. Pour une histoire décentrée ». Elle est membre du comité de sélection du Prix pour la photographie du musée du quai Branly Jacques Chirac, dédié à la photographie contemporaine. Ses recherches ont notamment porté sur les photographies de Gaëtan Gatian de Clérambault au Maroc en 1918-1919, sur la photographie dans les cours royales en Asie, sur les femmes photographes et sur les pratiques visuelles contemporaines en Australie.

Gaétan Gatian de Clérambault « Femme avec théière »
Femme voilée intégralement, elle se penche pour saisir une théière ; photographie prise devant une tenture, 1918-1919 : date de prise de vue. © musée du quai Branly – Jacques ChiracClérambault, Gaëtan Gatian de © musée du quai Branly – Jacques Chirac
Marie de la Fresnaye. A quand remonte vos liens avec l’artiste ?
Annabelle Lacour. C’est une collaboration qui s’est construite sur plusieurs années depuis notre première rencontre avec Hoda Afshar en 2019. Elle était alors en résidence à Paris et avait commencé à s’intéresser aux photographies coloniales réalisées en Afrique du Nord, en particulier les cartes postales orientalistes du « harem colonial [1]», des images stéréotypées et érotisantes de femmes voilées ou dévoilées, parfois dénudées. L’artiste se demande comment apporter une réponse à cette imagerie orientaliste sans réactiver la violence de ces clichés qui ont déjà tant circulé. Elle va donc élargir sa recherche à d’autres fonds pour explorer les manières dont la photographie a été pratiquée au début du XXe siècle en Afrique du Nord en contexte colonial. Lors de notre première rencontre au musée en 2019, je lui parle de différents corpus dont le fonds de Gaëtan Gatian de Clérambault dont l’histoire et la singularité visuel en font un matériau particulièrement intéressant et intrigant. Il s’agit d’un fonds important d’environ un millier de photographies. De nombreux artistes mènent des recherches à partir de la collection photographique, mais cela n’aboutit évidemment pas systématiquement à des projets d’exposition. Avec Hoda Afshar j’ai rapidement pensé qu’il y avait un sujet très intéressant pour une exposition au musée, à la fois dans la manière dont l’artiste s’est emparée de ce fonds, et les questions qu’elle soulevaient autour de l’histoire du médium photographique qui dépassaient largement la dynamique de la représentation. L’artiste réfléchit depuis longtemps à la façon dont le corps des femmes a toujours été au cœur de luttes politiques et idéologiques en particulier dans le monde arabe, et comment cela passe beaucoup par l’image. Cela est également lié à son propre parcours de migration, puisqu’elle a quitté l’Iran pour rejoindre l’Australie en 2007. Quand elle arrive en Australie, elle est marquée par la manière dont les autres perçoivent son identité de femme iranienne.
[1] Expression empruntée à Malek Alloula, Le harem colonial : images d’un sous-érotisme

Vue de l’exposition « Hoda Afshar. Performer l’invisible » proposée au musée du 30 septembre 2025 au 25 janvier 2026. © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine
MdF. Qui est ce personnage Clérambault ?
AL. Clérambault était un psychiatre, une figure majeure de l’aliénisme en France, actif au début du XXème siècle, notamment connu pour ses travaux à l’Infirmerie spéciale la préfecture de police où il était chargé de décider du placement des patients au moyen d’un certificat synthétique qui établissait un diagnostic rapide et précis du trouble mental des individus observés. Figure controversée pour ses méthodes, pas très populaire de son temps, il était très conservateur, critiqué par les surréalistes dans les années 1920. Aspect moins connu de sa biographie, Gaëtan Gatian de Clérambault est également l’auteur d’une vaste recherche sur les techniques du drapé. En 1917 il est mobilisé au Maroc alors protectorat français pour servir aux services de santé de Fès, et il a ensuite été conseiller technique en psychiatrie du général Lyautey, premier résident général du protectorat. Il va alors entreprendre un vaste projet ethnographique d’étude du haïk marocain qui s’intéresse en particulier à la structure du vêtement, aux plis de l’étoffe en fonction des mouvements, aux étapes d’habillement, aux questions techniques ce qui motiva la production de quantité de photographies. Il y a dans ses images une recherche évidente de classification des drapés. Certaines photographies, présentées à l’exposition coloniale de Marseille de 1922, lui ouvriront la porte d’un enseignement à l’Ecole des Beaux-arts sur le « costume drapé arabe ». Atteint de cataracte, il perd progressivement la vue et se suicide le 17 novembre 1934 face à un miroir. Le parcours de Clérambault, ses écrits psychiatriques – notamment son traité de 1908, Passion érotique des étoffes chez la femme – et le scandale de son suicide à la sinistre mise en scène n’ont cessé de fasciner le public mais aussi d’influencer la lecture et les interprétations faites de ses images.

Hoda Afshar, The Fold. Installation photographique Images source : Fonds Clérambault, musée du quai Branly – Jacques Chirac © musée du quai Branly – Jacques Chirac
MdF. Quel a été le déclencheur du choix de l’artiste pour ce corpus ?
AL. Ce fonds photographique a retenu l’attention de l’artiste pour plusieurs raisons. Tout d’abord la singularité des images et du projet de Clérambault, très différent des photographies orientalistes composées dans les studios : le sujet principal des photographies est le drapé et non le corps des femmes sous le voile. Dans les images de Clérambault, le corps disparait, les visages sont cachés, le cadrage se recentre sur les plis du tissu. Par ailleurs, le contexte historique de leur création est un élément important. Le choix de l’artiste de travailler à partir de photographies réalisées par un psychiatre français au Maroc en contexte colonial lui permet de contourner les difficultés rencontrées lors de ses premières investigations sur la représentation des femmes et du voile pour interroger les logiques politiques et les structures idéologiques à l’origine même de la réalisation de telles images. A travers ce corpus l’artiste peut explorer la manière dont le médium photographique est devenu un outil central du colonialisme en Afrique du Nord et interroger l’héritage durable de ces pratiques sur notre manière de percevoir aujourd’hui les sujets islamiques. Les photographies de Clérambault ont suscité l’intérêt du public et de chercheurs depuis leur redécouverte au musée de l’Homme dans les années 1990. Elles ont donné lieu à de nombreuses interprétations et différentes lectures. En cela ce corpus est aussi révélateur de la manière dont la photographie a cette capacité à ouvrir des récits, suscité des interprétations, qui se reconfigurent à l’infini suivant le moment et la personne qui la regarde. Enfin la question des intentions réelles de Clérambault et le mystère derrière l’objet de sa recherche sont un autre aspect qui a intéressé Hoda Afshar.

Vue de l’exposition « Hoda Afshar. Performer l’invisible » proposée au musée du 30 septembre 2025 au 25 janvier 2026. © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine
MdF. Quelle méthodologie du traitement de l’archive ?
AL. Hoda Afshar prend conscience que la complexité de ce fonds, qui ouvre de multiples pistes de réflexion, rend impossible une réponse unique ou définitive. Son œuvre The Fold se déploie ainsi en quatre volets, lui permettant d’explorer différents aspects de cette archive à travers un large éventail de stratégies visuelles et de techniques artistiques — du tirage argentique à l’animation numérique, en passant par une installation de miroirs et une création sonore.L’installation photographique composé de 900 tirages est le résultat d’une sorte d’accident et de hasard : lors de ses premières recherches sur la base de données en ligne du musée, l’artiste a voulu sauvegarder les images de la collection Clérambault mais elle s’aperçoit que le site recadre automatiquement les images sur des détails lors du téléchargement, ne donnant à voir que des fragments. Elle décide de poursuivre la constitution de sa propre collection d’images fractionnée de drapés. Cette installation parle ainsi de l’excès, de l’obsession, de la répétition à l’œuvre dans le projet de Clérambault, mais en même temps, en fractionnant l’image, l’artiste perturbe l’accès à l’archive. C’est également le concept du livre, publié chez Loose Joints Publishing à l’occasion de l’exposition, avec cette succession d’images recadrées qui ne permet pas d’accéder à la totalité, compromet le projet scientifique de Clérambault et remet également en cause la prétendue véracité de l’image photographique. Le processus créatif implique également toute une chaine technique : à partir des vignettes numériques, l’artiste réalise des négatifs qu’elle va ensuite tirer en positif dans la chambre noire, opérant un renversement de la chaîne habituelle du traitement d’une collection de photographie pour revenir sur la matérialité du tirage.

Vue de l’exposition « Hoda Afshar. Performer l’invisible » proposée au musée du 30 septembre 2025 au 25 janvier 2026. © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine
MdF. L’installation des miroirs imprimés : quels enjeux ?
AL. L’artiste a souhaité reproduire à échelle humaine une séquence photographique de Clérambault qui décompose le mouvement pour comprendre les différents gestes, les différentes étapes d’habillage, le déploiement de l’étoffe. Elle a choisi une séquence en particulier qui est presque abstraite car le corps disparaît complètement sous le drapé, il devient une sorte de mannequin -l’image opère une véritable objectification du corps. L’idée du miroir est très intéressante aussi parce que le regardeur est confronté à son propre reflet. Introduire le corps du spectateur permet à l’artiste de rappeler que nous voyons toujours les images à travers notre propre subjectivité, notre personne, notre éducation, notre bagage culturel. Le miroir est aussi un motif récurrent dans l’histoire de l’art et nous le retrouvons également dans la composante filmique de The Fold. Il fait aussi référence à un élément biographique de la vie de Clérambault, puisqu’on raconte qu’il s’est suicidé face à un miroir.
MdF. Dans le film, y a un certain nombre de témoignages de personnes qui viennent d’univers très différents.
AL. Il y a une véritable montée en puissance dans le parcours de l’exposition qui est conçu comme une sorte d’enquête sur la figure même de Clérambault et sur ses images, mettant en évidence la persistance d’une forme de mystère autour de la finalité et des motivations de Clérambault. Le spectateur progresse dans l’enquête jusqu’à son arrivée devant le film, avec cette série d’entretiens. Influencé par l’esthétique du film noir, les entretiens sont filmés dans un décor inspiré de la maison des miroirs dans La Dame de Shanghai (1947) d’Orson Welles utilisée pour évoquer la complexité de personnages aux facettes multiples et contradictoires. Les chercheurs interrogés sont issus de différentes disciplines, ils vont émettre des hypothèses ou réfléchir par rapport à leurs propres biais, leur bagage académique. On perçoit alors à quel point la vie d’un personnage, en fonction de nos propres domaines de recherche, va être racontée de manière très différente.
MdF. Vous aviez déjà travaillé autour de Clérambault pour votre master
AL. J’ai réalisé un mémoire de recherche à l’Ecole du Louvre en 2010 sur les photographies de Gaëtan Gatian de Clérambault. En 2019 j’ai publié un article pour la revue Transbordeur, qui est une synthèse de mes recherches. Dans les années 1990 et 2000 il y avait eu plusieurs publications qui avançaient des informations parfois parcellaires ou erronées sur Clérambault, c’est pourquoi j’ai tenu à engager ce travail de recherche et de réévaluation. C’est un fonds de la collection du musée qui intéresse un grand nombre de personnes avec des profils très différents.
J’ai écrit ce mémoire il y a quinze ans et je suis régulièrement sollicitée sur ce fonds par des chercheurs de divers horizons, des artistes qui vont s’y intéresser pour différentes raisons. C’est un sujet qui revient régulièrement, j’ai parfois la sensation d’être poursuivi par Clérambault ! En travaillant avec Hoda Afshar autour de son projet The Fold, je m’y suis à nouveau replongée, avec de nouvelles perspectives et de nouveaux questionnements, notamment dans le cadre de la rédaction de l’article pour la publication chez Loose Joints.

Vue de l’exposition « Hoda Afshar. Performer l’invisible » proposée au musée du 30 septembre 2025 au 25 janvier 2026 © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine
MdF. Pour aller vers l’autre volet « Speak the Wind » lié à des phénomènes de croyance dans une région du sud de l’Iran : qu’est-ce-qui est en jeu ?
AL. Avec The Fold Hoda Afshar explore directement un corpus d’archives pour la première fois dans sa pratique. Quand l’opportunité du projet d’exposition au musée s’est confirmée, il m’a semblé important de montrer un autre travail où l’artiste utilise la photographie et la vidéo, et donne à voir sa propre écriture visuelle. Il était également intéressant de dégager une cohérence dans les recherches qu’elle mène depuis quinze ans sur le médium même de la photographie, son histoire et son héritage par rapport aux logiques de pouvoir et d’idéologie des discours. Speak the Wind explore l’histoire de cette région du sud de l’Iran, à la culture, aux rites, et aux croyances autour des vents extrêmement violents, et interroge en même temps l’héritage de la photographie documentaire et ethnographique. L’artiste découvre également que la région est marquée par l’histoire de l’esclavage depuis l’Afrique de l’Est, et de nombreux habitants sont des descendants d’esclaves, de commerçants et de marchands d’Afrique de l’Est. Donc il y a différentes couches d’histoires qui s’entremêlent comme souvent dans ses projets et une volonté de raconter ces histoires méconnues, invisibles. Pour ce projet elle va s’intéresser au vent comme force physique et spirituelle. Elle veut se placer du point de vue des habitants et ne pas avoir ce regard surplombant de l’étrangère qui pose un regard objectif sur des croyances. Elle s’efforce de donner forme à l’invisible — au vent, à la magie — et d’explorer le lien entre la magie et les forces naturelles, un lien profondément ancré dans la plupart des cultures et que la culture moderne occidentale a progressivement perdu.
MdF. En ce qui concerne les actions du musée en faveur de la collection et de créateurs contemporains, quelles sont les priorités, les axes que vous défendez ?
AL. La collection du musée réunit plus de 710 000 photographies, anciennes et contemporaines. Pour le contemporain, dès son ouverture, le musée a choisi de se concentrer sur la création photographique contemporaine extra-européenne. Ce choix s’explique par la composition de la collection historique, majoritairement constituée d’images d’auteurs européens ayant photographié le reste du monde. Ces dernières années, cependant, notre politique d’acquisition a visé à mieux documenter et représenter les premiers auteurs locaux de différents pays y compris pour la partie plus historique. Pour la création contemporaine, notre intérêt s’est porté d’emblée sur les quatre continents représentés par le musée et sur la diversité des scènes photographiques internationales.
Cet engagement s’est traduit de plusieurs façons : par des achats auprès de galeries, par la création de la biennale Photoquai — interrompue en 2015 — ainsi que, dès 2008, par le lancement du programme de Résidences photographiques du musée. En 2022, ce programme a évolué pour devenir le Prix pour la Photographie du musée du quai Branly – Jacques Chirac.
Ce Prix constitue un dispositif de soutien à la création contemporaine. Chaque année, trois lauréats sont sélectionnés par un jury international et des personnalités du musée pour mener à bien un projet photographique. Chacun reçoit une dotation de 30 000 €, destinée à financer la conception et la réalisation du projet. Les lauréats sont ensuite invités à Paris pendant une semaine afin de produire leurs tirages qui entrent ensuite dans la collection du musée. Ce prix contribue donc à l’enrichissement de la collection contemporaine, toujours en développement. En 17 ans d’existence, le Prix pour la Photographie a permis d’intégrer 44 travaux photographiques, soit l’équivalent de 747 tirages, aux collections publiques nationales. L’un des aspects les plus précieux de ce programme réside dans sa capacité à révéler des scènes et des artistes moins visibles sur les circuits internationaux établis — par exemple des photographes originaires du Tchad, du Népal, du sud de l’Inde.
De plus nous avons développé depuis deux ans un partenariat avec le Musée Théodore Monod d’art africain, IFAN de Dakar, où nous élaborons des projets d’exposition à partir des travaux réalisés dans le cadre du Prix pour la photographie. Nous assurons le commissariat avec ma collègue Christine Barthe et Malick Ndiaye, le directeur du musée.
Nous avons également régulièrement des projets d’exposition de photographie au musée du quai Branly, dans le domaine du contemporain ou plus historique. En 2023, nous avons notamment conçu un important projet d’exposition en co-commissariat avec Christine Barthe, « Ouvrir l’album du monde : Photographies 1842-1911 », qui est le résultat de près de 10 ans de recherche. L’exposition s’intéressait aux débuts de la photographie en dehors de l’Europe et était l’occasion de montrer des pièces historiques très importantes de la collection, mais aussi des acquisitions récentes orientées sur les productions locales.L’espace de la boîte art graphique situé dans le parcours permanent du musée permet aussi de réaliser des accrochages thématiques autour de la collection. Actuellement nous présentons une partie du travail d’Emilio Azevedo, ancien lauréat du Prix pour la photographie, avec son projet Rondonia (comment je suis tombé amoureux d’une ligne).
MdF. Et en ce qui concerne les acquisitions contemporaines, quelle est votre politique ?
AL. En dehors du Prix pour la photographie, nous faisons des achats auprès de galerie pour des artistes plus confirmés, généralement des artistes en milieu de carrière, avec des œuvres abouties, déjà reconnus dans leur pays mais n’ayant pas d’œuvres dans les collections françaises. L’enjeu est aussi de pouvoir acquérir des pièces avant que leur cote sur le marché ne les rende inatteignables. J’ai mené plusieurs projets d’acquisition récemment pour le contemporain : l’oeuvre The Fold d’Hoda Afshar en 2025 – il était important pour moi de pouvoir en faire l’acquisition avant son exposition au musée – l’œuvre Windows on the West de l’artiste égyptienne Heba Amin (actuellement présenté dans le parcours permanent), l’œuvre Ritual and Ceremony de l’artiste aborigène australienne Maree Clarke, (qui sera présentée dans le parcours permanent en fin d’année).
MdF. Dernière question plus personnelle : comment êtes-vous venue à vous dédier entièrement à la photographie ?
AL. J’ai un parcours assez traditionnel, j’ai suivi le cursus à l’École du Louvre, en histoire de l’art puis muséologie, avec une spécialisation en histoire de la photographie et en art contemporain. Mes travaux de recherche de deuxième cycle ont porté sur des corpus liés à des pratiques et des usages de la photographie dans un contexte colonial en Afrique du Nord, puis en Indonésie. J’ai eu l’occasion par la suite de travailler au département de la photographie, à la National Gallery of Australia, (Canberra) sur un fonds de photographies d’Indonésie. Puis j’ai travaillé au Centre Pompidou Metz davantage sur des projets contemporains, et à partir de 2016 à l’Agence France Muséums pour le projet du Louvre Abu Dhabi, en tant que chargée de recherche et d’exposition. Dans ce cadre j’ai commencé le travail de recherches pour l’exposition « Ouvrir l’album du monde ». Cette grande exposition, dont j’ai partagé le commissariat avec Christine Barthe, a d’abord eu une première occurrence au Louvre Abu Dhabi en 2019 pour être ensuite revue et augmentée pour sa présentation en 2023 au musée du quai Branly. Il s’agissait d’un travail de recherche majeur qui a également guidé nos axes d’acquisition au musée ces dernières années. Pour ce projet, nous avons mobilisé un réseau international de spécialistes, en particulier dans le cadre de la publication de l’ouvrage Mondes photographiques, histoires des débuts, paru en 2023. Depuis mes sept années passées au musée, je me suis parallèlement beaucoup investie dans le Prix pour la Photographie ainsi que dans les actions autour de la création contemporaine.
Infos pratiques :
Hoda Afshar,
« Performer l’invisible »
Jusqu’au 25 janvier 2026
Musée du Quai Branly Jacques Chirac
à découvrir également lors de votre visite :
AMAZONIA, Créations et futurs autochtones
Le fil voyageur, raconté par Sheila Hicks et Monique Lévi-Strauss
Rondônia (comment je suis tombé amoureux d’une ligne)
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions