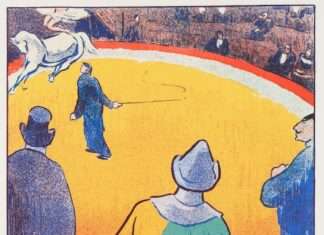Vue de l’exposition Alina Szapocznikow Le Langage du corps © ADAGP, Paris 2025. Courtesy The Estate of Alina Szapocznikow | Galerie Loevenbruck, Paris | Hauser & Wirth Crédit photo : Ville de Grenoble/musée de Grenoble – Nicolas Pianfetti
L’exposition d’Alina Szapocznikow par le musée de Grenoble est un évènement. En effet si l’artiste a bénéficié d’une reconnaissance dans son pays natal, la Pologne, elle est relativement restée dans l’ombre en France malgré les expositions de l’ARC en 1973 et du Centre Pompidou (cabinet d’arts graphiques). Inclassable, insolente, rétive à toute forme d’enfermement alors qu’elle est repérée et soutenue par Pierre Restany, le chef de file des Nouveaux Réalistes, ses recherches sur le corps la rapprochent de Louise Bourgeois qu’elle rencontre à plusieurs reprises. Mais n’allons pas trop vite.
L’histoire de la sculptrice juive, rescapée des camps, ses traumas se confond avec une urgence vitale à créer dans des œuvres viscérales où la chair le dispute à la décomposition, l’érotique à l’abject, la vulnérabilité à la survivance. Faite de ruptures, son œuvre épouse les soubresauts de la maladie et de la mort dans un flux impétueux que Sébastien Gokalp, directeur du musée de Grenoble et Sophie Bernard, commissaire nous proposent de démêler. Sébastien Gokalp revient sur la genèse de cette nécessaire relecture d’une œuvre pionnière, entreprise avec le Kunstmusem de Ravensburg et accompagnés par le galeriste Hervé Loevenbruck et de nombreux prêteurs internationaux. Depuis son arrivée au musée, il défend également un regard croisé des collections à partir d’invitations lancées à des artistes contemporains, comme Guillaume Bresson qui rejoue la chute dans l’histoire de la peinture. Sa politique d’ouverture le conduit également à développer la place de la photographie dans la collection à la suite des donations d’Antoine de Galbert, mécène et collectionneur, originaire de la région de Grenoble. La question de la photographie vernaculaire avec « Éloge de la photographie anonyme » est au cœur des enjeux qu’il défend alors que le musée prépare une programmation spéciale autour du Bicentenaire de la photographie. Sébastien Gokalp a répondu à mes questions.

Portrait de Sébastien Gokalp, crédit photo : Ville de Grenoble/musée de Grenoble – J.L.Lacroix
Vous avez pris la direction du musée de Grenoble après avoir dirigé le musée national de l’Histoire de l’Immigration : quel projet portez-vous à Grenoble ?
Mon projet est d’ouvrir le musée. C’est l’un des plus beaux d’Europe et je souhaite le rendre accessible au plus grand nombre en donnant notamment des clés de compréhension artistiques et historiques pour qu’au final chacun puisse profiter de la dimension artistique délestée des éventuels blocages ou réticences.

Vue de l’exposition Alina Szapocznikow Le Langage du corps Crédit photographique : Ville de Grenoble/musée de Grenoble – Nicolas Pianfetti
Avec l’exposition Alina Szapocznikow vous comblez une lacune en termes de reconnaissance en France : qu’est ce qui explique qu’elle soit restée dans l’ombre ?
Plusieurs facteurs sont assez identifiables : le fait qu’elle soit une artiste femme, une artiste étrangère venu d’un pays, la Pologne qui n’avait pas de réseaux importants en France.éventuellement son identité juive même si elle ne la met pas en avant ; et surtout sa très grande indépendance que ce soit dans son parcours professionnel et sa démarche artistique.
Malgré sa proximité avec Pierre Restany, le grand critique d’art français des années 1960 qui a inventé le Nouveau Réalisme, elle n’a pas adhéré au mouvement alors qu’elle travaillait avec des matériaux proches de César notamment. Elle s’engage également sur le moulage de son propre corps comme le sculpteur, ce qui représentait peut-être une forme de concurrence.
D’autre part, une œuvre radicale et particulière qui aborde l’intime et notamment féminin comme Louise Bourgeois qu’elle a connu. Elle travaille sur l’informe, des éléments qui dans la période où elle se trouve en France dans les années 1960 ne sont pas regardés. La période est plus portée un regard sur la société de consommation, la figuration narrative, le Pop art américain ou un art critique institutionnel avec Buren, Parmentier, Toroni, ou plus formel avec Support Surfaces. Une œuvre aussi intime ne trouve pas son écho dans cette décennie, les mythologies personnelles devenant le sujet de l’art dans les années 1970 avec notamment deux artistes qui vont beaucoup apprendre d’elle, ses voisins à Malakoff : Christian Boltanski et Annettte Messager. L’artiste a bénéficié en revanche d’une forte reconnaissance en Pologne et très tôt.
En quoi son œuvre est-elle pionnière pour de nombreuses générations ?
C’est une artiste en termes de technicité est une grande sculptrice qui utilise tous les matériaux classiques ou nouveauxet investit tous les formats : monuments ou sculptures plus petites et proches du design. Pour autant ce n’est pas une œuvre virtuose formellement mais qui parle de son identité, de sa vie de femme déportée, malade ou jouissante. Ce regard sur l’identité et l’intimité est aujourd’hui quelque chose de très présent. Pour cela elle utilise des sculptures qui ont des formes sublimes, si l’on pense à ces ventres ou ces lampes et qui renvoient aussi à l’informe, à la maladie, la mort, la tumeur. Quelque chose que l’on ne peut pas expliquer ou décrire avec des mots mais que l’on sent de manière viscérale. Partir de l’intérieur et ne pas faire une œuvre conquérante qui viendrait orner un salon ou un rond-point mais quelque chose qui parle de soi.
Quels sont les variantes et compléments par rapport à l’exposition du musée de Ravensburg ?
Ils ont travaillé pendant 4 ans autour du projet de l’exposition. Nous avons souhaité mettre plus l’accent sur la partie française avec un plus grand nombre d’œuvres disposant de plus de place. Certains textes ont une saveur différente s’ils sont traduits ou non. De nombreux dessins et des sculptures ont été prêtés par le galeriste Hervé Loevenbruck comme les modelages de bouches encore jamais montrés, mettant en avant le travail de design ou en série.
Nous bénéficions de nombreux prêts des musées polonais dont des grandes sculptures des années 1960 qui n’étaient pas à Ravensburg.

Vue de l'exposition Guillaume Bresson En regard. © ADAGP, Paris 2025 Crédit photo : Ville de Grenoble/musée de Grenoble - Nicolas Pianfetti
Dans le cadre du cycle « En regard », Guillaume Bresson après le Château de Versailles, poursuit un dialogue avec les chefs d’œuvre de la collection : que souhaitez-vous encourager avec ce projet ?
L’idée est d’encourager à aller voir les collections permanentes. Souvent on dit j’ai fait le Louvre alors que ce n’est pas en une seule visite que l’on peut apprécier les 250 000 chefs d’œuvre du musée ! C’est comme une piste de ski, on peut le refaire et en profiter. On peut regarder une œuvre 10 fois et à chaque fois ce sera différent selon l’état de disponibilité, l’âge, le temps dont on dispose… Personnellement c’est l’un des grands plaisirs que je m’accorde quand j’ai fini de travailler, celui de descendre dans les salles pour voir les œuvres. Pour aider le visiteur à voir les œuvres différemment on les met en regard avec quelque chose à la fois de différent et de similaire. Le principe est de demander à des artistes contemporains de réagir à ces œuvres classiques, les artistes étant les meilleurs connaisseurs de l’art, ceux qui voient le plus. Ils se nourrissent des œuvres et vont chercher des choses que le commun des mortels, quelqu’un comme vous et moi ne voit pas pour les lui révéler. Ce regard nous amène à voir différemment les œuvres pour en percevoir toute la contemporanéité. Inversement l’artiste contemporain qui est inscrit en face à face avec l’art classique se retrouve dans une histoire de l’art sur du très long terme. Cela nous montre ce qu’il peut y avoir de classique dans une œuvre contemporaine.

Vue de l’exposition Guillaume Bresson En regard. © ADAGP, Paris 2025 Crédit photo : Ville de Grenoble/musée de Grenoble – Nicolas Pianfetti
La place de la photographie dans la collection s’est vue renforcée par les donations d’Antoine de Galbert : est-ce un axe de la collection que vous souhaitez mettre en avant ?
Le musée s’appelait à l’origine musée de Peinture et de Sculpture avant de devenir le musée de Grenoble. Si la collection en peinture est majeure, l’artiste dispose à présent d’un grand nombre de techniques qu’il peut maitriser ou en déléguer la pratique, l’idée de concevoir une collection par médium ne gardant son sens qu’en termes de conservation mais plus d’un point de vue artistique. Il ne convient donc plus de cantonner les collections du musée à la peinture et sculpture mais l’ouvrir à d’autres domaines comme la photographie ou la vidéo. Nous partons d’une centaine de photographies d’art contemporain et d’un fonds conséquent d’art classique du XIXe (fonds Fantin-Latour).
Antoine de Galbert, grand mécène du musée qui a tenu une galerie à Grenoble pendant 10 ans et a grandi dans la région a souhaité favoriser l’enrichissement de ces collections à travers deux donations. D’une part avec « Une histoire d’images » qui a donné lieu à une exposition en 2023 à partir de 300 photographies, complétée récemment par « Éloge de la photographie anonyme » la Collection Marion et Philippe Jacquier, fondateurs de la galerie Lumière des Roses. Ce domaine de la photographie vernaculaire est encore peu développé en France d’où l’envie de commencer à partir de ces 11 000 photos qui ont été exposées à Arles cet été.
Quelle sera la programmation autour de ce Bicentenaire de la photographie ?
Nous allons commencer dès le mois de mars autour de deux expositions avec d’une part le photographe Bernard Descamps et d’autre part, Charlotte Perriand autour de ses photographies de montagne.
A partir d’octobre, nous exposerons de nouveau des photographies autour du thème de la montagne mais celles de Bernard Plossu.Nous allons aussi présenter des donations de photographies. Notamment celles du photographe Patrick Bailly-Maître- Grand et des ensembles pas forcément présentés à Arles avec la collection la Lumière des Roses comme « l’Album de Rose et Jean ».
Question plus personnelle : à partir de quel moment avez-vous décidé de consacrer votre vie à l’art ?
Il y a eu deux temps. Adolescent,j’ai commencé à dessiner et à peindre jusqu’à entrer à l’École des Beaux-arts de Paris à 19 ans. J’ai commencé ma carrière comme artiste et c’est la rencontre avec le monde de la conservation, notamment Laurent Le Bon avec qui je travaillais qui m’a ouvert sur de nouveaux enjeux. Après une expérience au Centre Pompidou, j’ai réalisé que je voulais devenir conservateur. J’ai donc passé le concours de l’Institut national du patrimoine, tardivement, pour poursuivre dans l’art mais de façon différente.
Catalogue 272 pages, Liénart éditions 32,00 €
(disponible à la librairie du musée)
Infos pratiques :
Alina Szapocznikow
Le Langage du corps
Jusqu’au 4 janvier 2026
https://www.museedegrenoble.fr/3321-alina-szapocznikow.-langage-du-corps.htm